Joëlle Zask
Outdoor art
La sculpture et ses lieux
Paris, Ed. La Découverte, 2013
Introduction
« Si je tiens à ce que la sculpture ne soit pas architectonique, je n’aime pas non plus qu’elle devienne un simple décor. À un certain moment, l’accumulation plastique cesse d’être sculpturale ; elle perd sa spécificité et devient purement décorative, comme un papier peint ou un tapis. Entre ces deux extrêmes, il existe un point où l’œuvre fonctionne pour soi tout en étant située dans l’espace. C’est ce point-là que j’ambitionne d’atteindre. »
Carl Andre[1]
Beaucoup d’œuvres d’art se trouvent à l’extérieur, dans les villes, entre les villes ou à leur périphérie, sur des ronds-points, dans la nature, sur des parcours ou dans les parcs. Certaines soulignent un bâtiment, d’autres, le centre d’une place, d’autres encore forment des aires de jeu pour les enfants. Parfois des espaces leur sont entièrement dédiés, comme les jardins de sculptures dont il existe de nombreux exemplaires. Il arrive qu’elles deviennent indissociables des lieux où elles sont installées, comme la statue de la liberté à New York ou la pince à linge d’Oldenburg à Philadelphie[2]; il arrive aussi qu’elles ne fassent que passer ou ne parviennent pas à s’installer durablement, comme Tilted Arc de Serra à New York ou le Mât des Fédérés de Buren à Marseille.
Elles sont de tous styles : statues, monuments, fresques, photographies, mobiles, mosaïques, jardins, lumières, installations, excavations, dispositifs sonores. Les matériaux dont elles sont faites sont aussi d’une grande diversité : béton, métal, carton, néon, bois, pierre de toute sorte, céramique, terre, basalte, résine, blocs de glace, matériaux de construction, miroirs, dispositifs électroniques, etc. Certaines sont faites pour résister aux intempéries, d’autres sont destinées à disparaître. Il y en a qui sont « nées pour être brûlées » ou d’autres qui, étant en glace, fondent progressivement[3]. Il arrive aussi que des œuvres passagères, à l’instar de Spiral Jetty de Smithson, soient tout de même conservées, grâce à de gros efforts techniques et d’importantes dépenses.
Comparé à l’art à l’intérieur, dans les musées, les galeries, les maisons, les châteaux, les églises, l’art à l’extérieur forme une catégorie particulière. Cependant cette catégorie est loin d’être homogène et les termes que nous employons ne sont pas clairs. Par exemple, il est fréquent que nous utilisions l’expression « art public » pour désigner un art qui est tout simplement dehors. C’est le cas du service culturel de la Ville de Montréal dont le site web explique que l’expression « art public » « désigne l'ensemble des œuvres situées dans des espaces urbains, tels les places publiques et les parcs, ou encore à des œuvres incorporées au mobilier urbain, à des édifices ou à l'aménagement paysager. Ce sont pour la plupart, et selon l'époque à laquelle ces œuvres ont pris place dans notre environnement, des monuments commémoratifs, des sculptures monumentales, des murales ou des éléments de l'aménagement paysager[4]. » Or l’art qui est placé à l’extérieur est parfois public, parfois privé. Tout dépend de la nature du commanditaire, de celle des fonds l’ayant financé, du lieu où il est situé, de ce qu’on appelle « public ». De même, il est fréquent que « l’art public » soit à l’intérieur, placé sous un toit.
Étant donné que les œuvres d’extérieur peuvent avoir un statut, une fonction, un rôle social ou politique, une valeur esthétique, extrêmement variables, je propose de les classer en sous-groupes afin de mettre au jour des distinctions qui pourraient avoir une double utilité : celle de revisiter l’histoire des arts en plein air, et celle d’aboutir à une typologie des combinaisons entre les œuvres, leurs usages sociaux et les enjeux politiques de leur implantation dont l’identification anime une partie importante de ce livre.
D’une manière générale, en art ou dans la conduite ordinaire (les manières de faire de l’art étant révélatrices des paramètres de base de notre conduite), il existe schématiquement trois façons d’être à l’extérieur : dans le premier cas, nous restons enfermés en nous-mêmes, nous sommes indifférents ou imperméables à ce qui se passe ou posons sur le monde et la nature un regard utilitaire, voire dominateur. Il est alors possible que nous allions jusqu’à détruire notre environnement. Nous ne nous en soucions que pour notre utilité et restons fermés à ce qui ne s’y plie pas. Par la domination, l’indifférence ou même le déni, nous imposons au monde extérieur notre logique et le formatons (« l’arraisonnons », écrivait Heidegger) de sorte qu’il lui obéisse, ou qu’il se taise. En art, il est fréquent que la statuaire urbaine classique soit exemplaire de ce cas : séparée par son socle de l’espace où se trouvent les bâtiments et les passants, les statues sont faites pour être vues par elles-mêmes, comme signe ou symbole, et non par l’intermédiaire des lieux où elles se trouvent, auxquels elles sont indifférentes, parfois même hostiles.
À l’autre extrême, il arrive que l’environnement soit « trop fort pour nous », comme l’écrivait Turner, l’historien de la frontier américaine, au sujet du monde sauvage[5]. Cela s’applique aussi à la « jungle » humaine, la « société », qui souvent broie les individus. Soit vous disparaissez, soit vous êtes assimilé, absorbé en elle. Là, il n’y a plus de négociations possibles, le monde ne tient pas compte de vous et vous annihile. Certaines œuvres in situ, éphémères, convenues, esthétiquement si faibles ou techniquement si inadaptées qu’elles n’ont ni consistance ni résistance, sont dans cette situation.
Enfin, il existe une situation intermédiaire, la seule qui m’intéresse ici et dont cet essai tente l’exploration : là, nous ne sommes ni dominé ni dominateur, mais en interaction avec le lieu ; ce lieu agit sur nous et nous agissons sur lui. Cette situation est celle de l’art outdoor, situé dehors. Le Groupe de quatre arbres de Dubuffet sur la place de la Chase Manhattan Bank à New York, la Bicyclette ensevelie d’Oldenburg dans le parc de la Villette à Paris, Stairway de Bruce Nauman dans le ranch des Oliver en Californie, Big Bambou des frères Starn sur le toit du Metropolitan Museum à New York, et bien d’autres, ont ce statut. Je dirai de ce seul groupe de sculptures qu’elles sont dehors au sens littéral, concret et imagé, du mot outdoor, côté extérieur de la porte, hors de la maison et de tout espace fermé. C’est à ce dehors, par opposition au dedans, que pensait Oldenburg quand il écrivait : « Il faut que l’art qui a si longtemps sommeillé dans des mausolées dorés et dans des cercueils de verre sorte prendre l'air, fume une cigarette, boive une bière (…) Il faut l’ébouriffer, lui apprendre à rire, lui donner des vêtements de toutes sortes, lui faire faire un tour à vélo ou dans un taxi avec une fille[6]. »
Pour réaliser ce programme, j’ai dû réduire les observations et les exemples à un domaine précis qui est encore trop vaste, celui des sculptures contemporaines et même, de seulement quelques-unes d’entre elles. Laissant de côté les questions d’histoire de l’art, de hiérarchies et de filiations, j’ai sélectionné dans ce domaine lui-même une petite région, celle qui concerne l’emplacement des oeuvres. Celui-ci découle parfois d’un choix délibéré, parfois d’une habitude, parfois d’un inconscient refoulé. Il est relatif aux bâtiments et à l’architecture, aux rues et aux places, aux possibilités de vision et de déplacement, aux éléments naturels, aux cours d’eau et au cours du soleil, bref, à l’environnement, naturel ou urbain.
Dans la mesure où les situations produites par les choix de localisation des sculptures n’ont été que peu analysées, il a fallu s’aventurer. En effet, que les décideurs concernés aient été les artistes eux-mêmes (ce qui est rarement le cas), les pouvoirs publics ou certains commanditaires particuliers, l’emplacement de l’œuvre n’a généralement pas été considéré comme une variable significative de l’histoire des formes et des pratiques sculpturales. Le célèbre ouvrage de Rosalind Krauss, Passages in Modern Sculpture (1977), de même que l’immense majorité des monographies, n’en font que rarement état. Le fait que, la plupart du temps, les documents photographiques accompagnant ces ouvrages représentent les sculptures dans des lieux tronqués, indifférents, neutralisés, souvent invisibles en raison d’un cadrage serré et vide d’hommes, renforcent la déréalisation de la question de l’implantation. Or, il me semble que s’en préoccuper est un bon moyen de mettre à l’épreuve non seulement la cohérence formelle et les innovations artistiques que l’œuvre considérée peut apporter mais aussi, plus généralement, la nature politique et sociale du mode d’existence publique qui se trouve être le sien.
Étant donné qu’il n’y a pas d’équivalent en français du terme outdoor et que, par ailleurs, des entreprises de décoration des lieux en plein air et d’affichage public, des fabricants de chaussure de marche et des traiteurs pour pique-nique situés en France s’en sont récemment emparés[7], j’ai pensé pouvoir en faire usage au fur et à mesure des besoins, plutôt que de leur abandonner. Au sujet des sculptures qui quant à elles ne sont pas en dialogue avec le lieu où elles se trouvent, soit parce que rien ne montre que l’environnement a été pris en compte, soit parce qu’elles s’y dissolvent, je dirai qu’elles sont simplement à l’extérieur.
Être dehors, out of doors, Thoreau le faisait remarquer, c’est être exposé aux intempéries. La pensée elle-même, écrivait-il, en est modifiée ; elle est, comme la peau, « tannée par le soleil ». Être dehors est aussi se trouver en un lieu dont les paramètres ne sont jamais intégralement sous contrôle. Le monde qui se trouve de l’autre côté de la porte quand on sort de la maison est un monde en partie inconnu. La nature et les gens y sont imprévisibles. Pour cette raison, notre attitude change : dedans, on est à l’abri ; notre environnement est intime, son fonctionnement, les objets qui s’y trouvent, ses dimensions, sont bien connus ; l’ensemble est « rassurant ». C’est parce que la maison est un lieu familier qu’elle est paisible. Dehors, on est au contraire exposé, comme une œuvre d’art. Du coup, on se met en alerte, notre regard balaie la situation, certaines circonstances que nous ignorions frappent notre curiosité, certaines nous attirent, d’autres nous repoussent. Alors que le dedans résulte de stratagèmes inventés pour se prémunir contre les effets du dehors, — par exemple la température et la lumière sont scientifiquement régulées dans les musées —, le dehors par définition nous affecte. Nous percevons son influence et, que nous le voulions ou non, nous sommes modifiés par lui : notre personnalité, nos idées et nos croyances, notre conduite, la manière dont nous nous déplaçons, sont travaillées, parfois profondément transformées, par l’expérience du dehors.
La relation au dehors proprement dit — qui ne se confond pas, selon la prémisse admise, avec l’extérieur en général, susceptible d’être détruit ou de nous détruire —, inclut un large spectre de perceptions et de situations : une fois dehors, nous pouvons éprouver de la frayeur, de l’inquiétude ou, à l’inverse, un sentiment d’allégresse, une excitation, une intense satisfaction. Dans ces diverses situations, notre attitude consiste avant tout à observer ce qui se passe. Que nous soyons effrayés ou que notre curiosité soit excitée, nous nous approchons pour décrypter le phénomène qui nous affecte, nous faisons varier les conditions de notre expérience. Bref, nous nous rendons disponibles à la perception qui nous arrive et nous sommes attentifs. Le mode d’existence outdoor est fondamentalement celui de l’attention.
Cette gamme de situations, si variées qu’elles soient, forme un tout nettement distinct des deux autres types déjà signalés, la domination et l’indifférence d’un côté, l’assimilation ou la fusion de l’autre : dans ces circonstances, l’interaction avec le dehors n’advient pas. Schématiquement, dans le premier cas, notre conduite, bien qu’à l’extérieur, est celle que nous aurions à l’intérieur, entre quatre murs. Si le dehors définit la part de l’expérience humaine provoquée par le fait de percevoir fortuitement une donnée que l’on reconnaît en même temps être telle, comme une sorte d’irruption du « principe de réalité », alors l’attitude consistant à neutraliser l’influence des réalités extérieures ou à s’y rendre insensible, qu’il s’agisse de gens, de phénomènes naturels ou de choses, est destructrice d’une relation avec le dehors. On pourrait dire de quiconque l’adopte, individu, artefact ou collectivité, qu’il est sans dehors[8]. Par ailleurs, si le dehors est l’occasion de réaliser un aspect de nous-mêmes par le fait que nous y participons, que nous répondons et ré-agissons à ce que nous en percevons, alors le fait de se fondre dans l’environnement, de fusionner avec lui, de faire un avec lui, de coller à sa demande ou de lui obéir docilement, est également destructeur d’une relation avec le dehors ; car dans de telles circonstances, il n’y a plus de dedans, indoor, c’est-à-dire de lieu où se retirer et où chercher à être cette individualité qui, tel un botaniste, rapporte à la maison les plantes qu’il a ramassées dans les champs et les étudie à l’abri. Il n’y a pas de dehors sans dedans.
Les œuvres qui sont véritablement dehors sont qualifiées par le fait d’être dehors. Contrairement aux œuvres situées dans des lieux fermés, indoor, c’est-à-dire derrière la porte qui se ferme sur elles et sur les gens qui viennent les voir, contrairement en particulier à celles qui sont placées dans ces espaces neutralisés que Brian O’Doherty a désignés par l’expression de « cube blanc » (white cube[9]), elle sont en interaction avec des situations où l’on fait autre chose que regarder des œuvres d’art, et où se trouvent toutes sortes d’éléments, intégrables et inintégrables, prévisibles et intempestifs. Même dans un jardin dédié aux sculptures, il y a des oiseaux et des mulots, des avions qui passent, la pluie qui tombe ou le soleil qui aveugle, le vent, le jour, la nuit. On y trouve aussi, outre des amateurs d’art, des familles et des vandales, des enfants qui jouent au ballon et des passants. Les sculptures situées dehors sont exposées aux intempéries ; leurs relations avec l’environnement ne sont pas unilatérales mais complexes et changeantes en fonction des conditions naturelles et aussi de l’espace et de l’époque d’où on les voit. Elles y séjournent comme si elles y étaient fortement attentives. Ceci étant, elles ne sont pas déterminées par l’endroit où elles se trouvent. Au contraire, elles lui apportent des qualités qu’autrement il n’aurait pas ou qui ne seraient pas tangibles. Celles qui marchent, soit qu’elles entrent en interaction avec l’environnement, soit qu’elles constituent un environnement distinctif, forment des « lieux ». Sans être ni tapageuses ni discrètes, elles existent en compagnie des autres éléments qui se trouvent là (arbre, réverbère, trottoir, plan d’eau), ainsi bien sûr qu’en compagnie des visiteurs, des passants, des riverains ou des regardeurs. A travers des exemples, ce sont les caractéristiques de cette configuration bien particulière, dont les implications sont autant esthétiques que politiques et sociales, que cet essai explore.
[1] Carl Andre[1], entretien avec Irmeline Lebeer (1974), dans L'art, c'est une meilleure idée, Editions Jacqueline Chambon, 1997, p. 42.
[2] Chothes Pin (1976), Center Square Plazza, Philadelphie, Etats-Unis.
[3] Mircea Cantor, Born to be burnt (2009), Johnen Galerie, bâtons d’encens d’un mètre de long ; Yoko Ono & Arata Isozaki, Penal Colony, 2004
[4] La collection d'art public de la Ville de Montréal est riche de près de 300 œuvres réparties sur tout le territoire de la métropole, dont 225 sur des sites extérieurs et 75 œuvres intégrées à l'architecture. http://ville.montreal.qc.ca/portal
[5] Frederick Jackson Turner, The Frontier In American History, 1883.
[6] Claes Oldenburg, cité par Diana Crane, The Transformation of the Avant-Garde: The New York Art World, 1940-1985, University of Chicago Press, 1989, p. 66.
[7] A preuve : <espaceoutdoor.com/magasin/1/Chaussures> ; <cbsoutdoor.fr>
[8] Cette acception peut être rapprochée de la « pensée du dehors » abordée par Michel Foucault, dans Critique n°229, juin 1966, repris dans Dits et écrits I, 1954-1975, dans la mesure où Foucault estime que cette pensée, même si elle est irréductible à l’intériorité, se forge non en interaction avec les éléments du dehors mais dans un « vide qui lui sert de lieu », par « la distance dans laquelle elle se constitue ».
[9] Brian O’Doherty, Inside the White Cube. The Ideology of the Gallery Space, The Lapis Press, San Fransisco, 1976.









/https%3A%2F%2Faoc.media%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F08%2Fcapture-d-e-cran-2018-08-22-a-15-04-05.png)


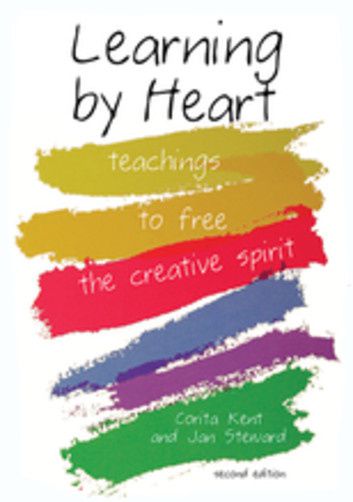


/http%3A%2F%2Fsurlaplacepublique.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F10%2Flogo.jpg)



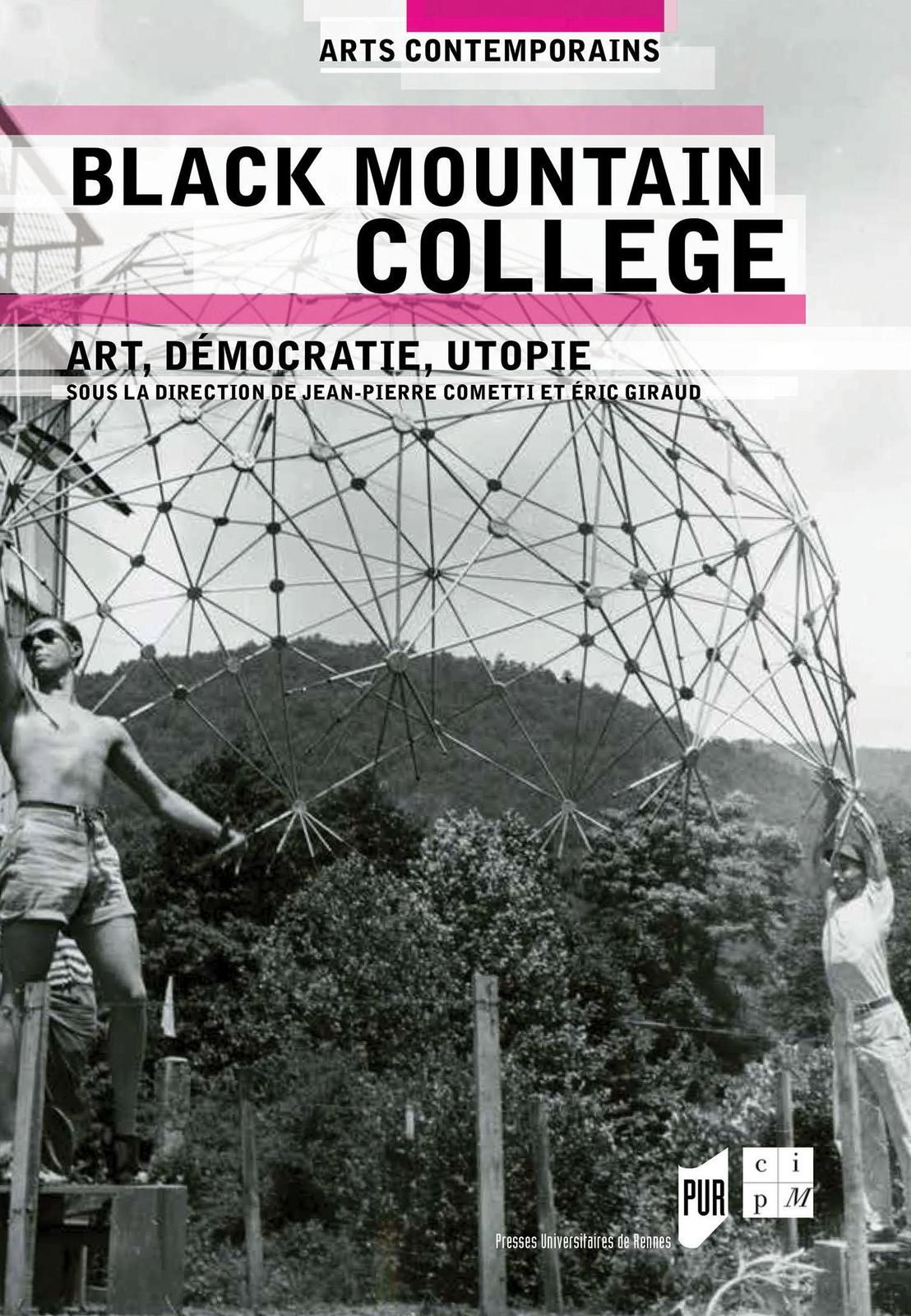
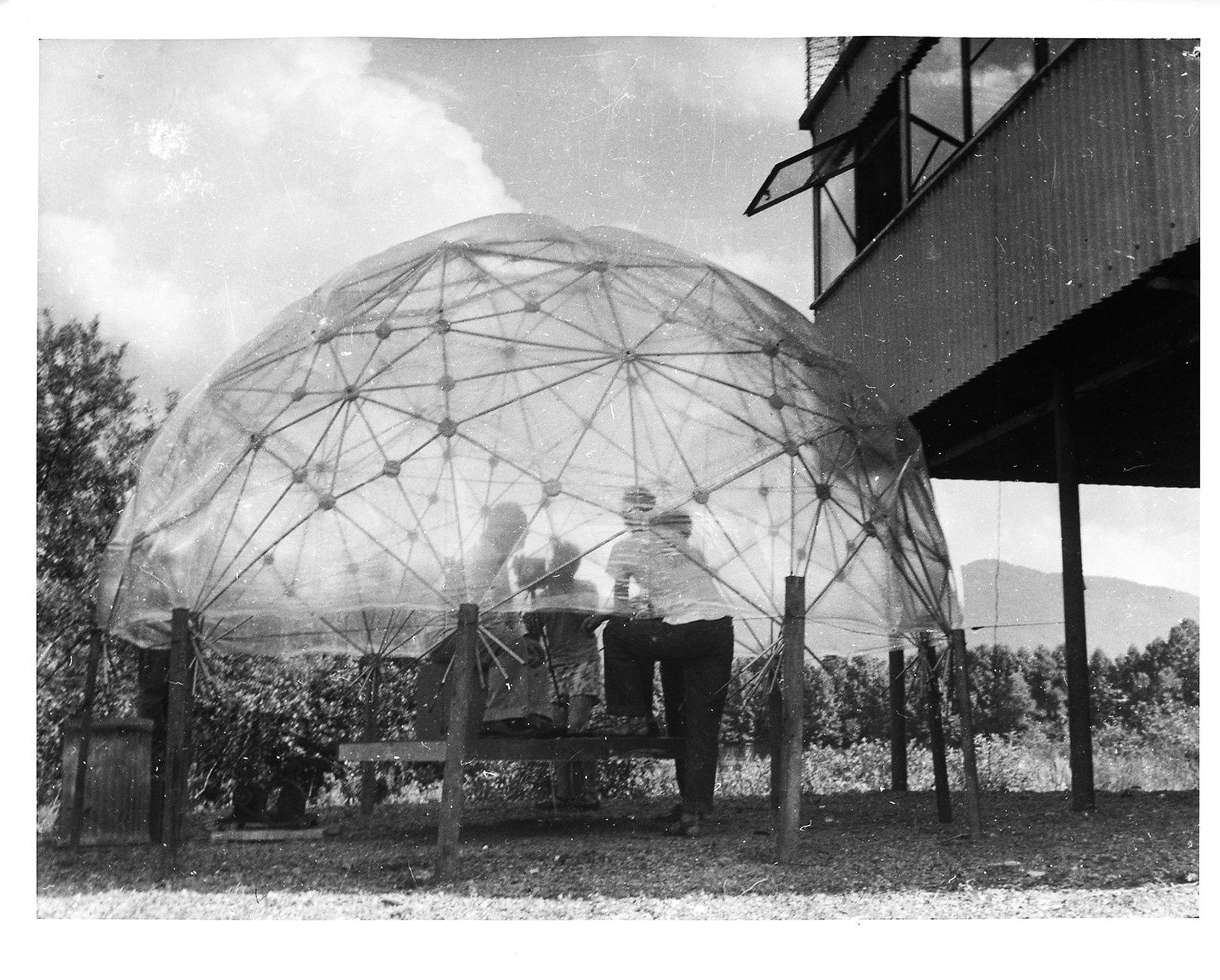
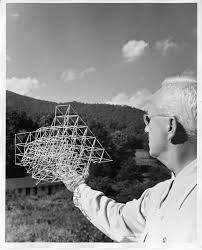











/image%2F0549945%2F20160207%2Fob_1e0e61_rond-poins-villeurbanne.jpg)
/image%2F0549945%2F20151104%2Fob_633289_6-lecorbusier-cite-radieuse-toit-cop.JPG)
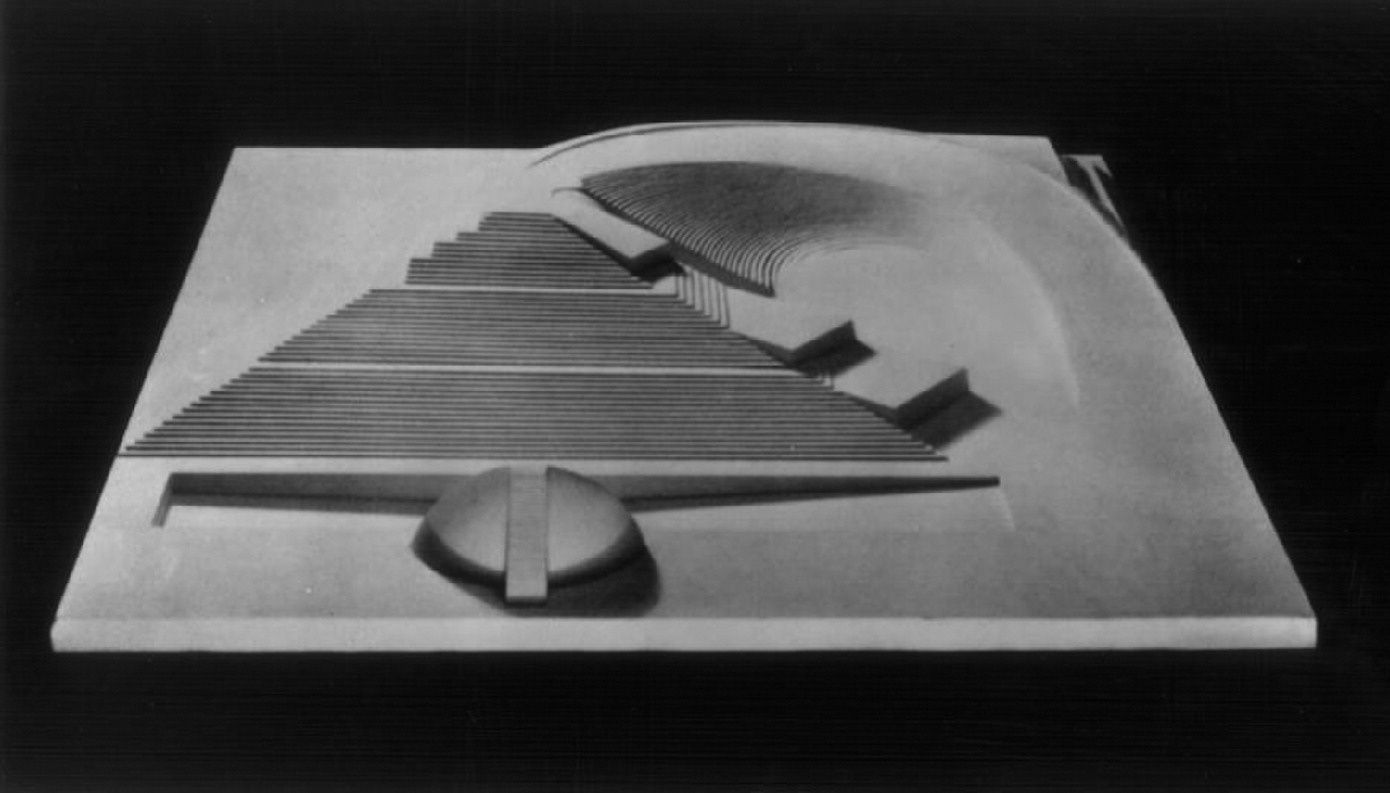

/image%2F0549945%2F201304%2Fob_e3d0d23d87b248e382aefac8dd06e764_p1020420.jpg)